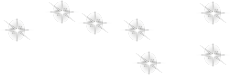Le Cristal de Roche
Frédérique de Carvalho, novembre 2003
contribution orale au colloque « poésie et réel », le Point de Capiton, Cavaillon
Le travail poétique et le cristal de roche
(je vais essayer de dire quelque chose)
Quelque chose précéderait que je ne saurais pas et que j’irais chercher,
- écrire, sinon, à quoi rime.
Le manque ouvert, la béance, ce qui engendre la quête, soit le mouvement de la main de l’écriture.
Et l’objet perdu de la quête, présent par son absence même, nécessaire seulement à la mise en chemin, à déclencher le geste, à initier le texte à venir.
L’objet trouvé, lui, surgissant de l’obscur, quelque trésor à l’inconnu de soi, s’écrit à mesure du texte dans un présent d’écriture qui se découvre à chaque instant. Un présent d’ex-istence, une mise hors de soi de ce qui, au conscient de l’être, ne pouvait surgir que dans la langue du poème, dans l’infini mystère de la mise au jour d’une nuit antérieure.
La nuit, l’antérieur, l’enfoui, le pli plié.
Le travail poétique de la langue commencerait là, dans une sorte de retour, dans une sorte de descente, et là, - dans l’entre-deux, l’inachevé présent de l’écriture. Un présent élaboré dans le passé toujours recouvert de nos mémoires d’oublis, passé qui s’énonce et se dénonce à mesure que s’écrit déjà le vers quoi je vais les yeux fermés, bandés vers un ailleurs à venir plus tard dans la phrase, un futur devenu prémonitoire d’un rappel du passé, rien d’autre que l’appel du réel. Écrire comme répondre.
Le réel alors point obscur ou centre incandescent, absent cependant de lumière si le poème ne vient pas rendre lisible la trame souterraine, s’il ne vient pas polir l’épaisseur de la gangue jusqu’à la transparence quasi illisible de ce qui s’est tissé dans l’envers du des-corps.
Poème de forêt, c’est l’instant précis du vent muet de la voix qui passe entre les branches.
Est-ce cela le secret des clairières à venir éclaircir des broussailles très denses, des entrailles cousues d’avance que le texte découd, - une guenille étrange tout entière de lambeaux disparus et revenus ?
Je n’ai rien inventé, je me suis souvenu écrit Jephan de Villiers. De quelle mémoire tait-il l’histoire, que puis-je lire à travers sinon le réel du poème, sinon le poème du réel ?
Le cristal de roche avant son extraction est une pierre vulgaire, un lieu commun de la terre.
– pareil le mot, la langue, pareil la langue avant le travail du poème. Le travail poétique vient convoquer l’en-deçà et l’au-delà des lieux communs que sont les mots communs, des mots connus de tous, utilisés et usés, apparemment. Et voici qu’apparaît à l’apparence, depuis la profondeur de glaise sémantique, un autre usage, un autre aspect, une autre facette du réel de langue, - c’est le réel de l’expérience poétique du monde.
La poésie force les mots à livrer leur ciel écrit André du Bouchet dans son Carnet de souffle.
Et Thierry Metz, dans l’homme qui penche
Poème 24
Un homme marche dans les feuilles,
non loin du pavillon. Il se déplace si
lentement, avec tant de précautions
qu’il ne voit pas qu’un arbre le suit.
Qui, sinon le poète, sinon Thierry Metz, poète, présent au monde, aurait pu voir, à travers la promenade solitaire d’un homme malade dans le jardin de l’hôpital psychiatrique de Cadillac, qui aurait pu voir et donner à voir l’arbre accompagnant l’homme dans la très lente absorption de ses pas dans l’allée du parc ?
Quoi peut dire sinon le poème ? Quoi taire d’autre du réel de l’homme et de l’arbre dans l’indicible compagnonnage de qui n’a plus de compagnon de son espèce ?
Le poème est une vision. Dans l’opaque et le brut de la pierre il lit le cristal. Le poète ne peut se contenter de la réalité « ordinaire », il n’en a pas les moyens ; s’il les avait, il n’écrirait pas.
Poème 79
Fatigue. Lassitude.
Mais ce qu’il faut écrire me dépasse.
Dans le réel la visite n’est jamais terminée.
Toute préméditation de dire quelque chose et pas autre chose est vaine. Ce qui s’écrit s’échappe et se précipite à l’avant de lui-même, pioche au fond de la mine, à suivre, sans autre indice que le mouvement de la main, la veine improbable dont rien, objectivement, ne laisse présager de la direction et du chemin qu’elle va emprunter.
Rien sinon la langue et le travail de la langue. C’est-à-dire le travail de la main et du bras et du corps tout entier avec l’âme ou l’esprit ou ce que l’on voudra nommer en place de ces mots pour nommer l’invisible de ça, - et qui habite, - là.
Serait-ce à dire le travail du poème comme à part le poète ou le travail du poème comme à l’inconscient du poète ? non, c’est, à dire, le conscient et l’inconscient du poète et autre chose encore, le réel, convoqués tous ensemble et dans le même espace-temps du poème.
Dans l’ouvert du réel demeure l’inachevé perpétuel de l’écriture.
Poème 80
Dominique occupe peu de place
dans le langage. Gros de corps,
Sumo d’un cercle que lui seul a
tracé, ses mots ne sont que
minceur ; expérience d’une autre
langue. On dirait qu’il n’y a plus,
près de lui, que l’enfant et la sage-femme.
Homme inaudible au visage rond
dont la mère aurait pris les traits –
revenant elle seule, par ce biais, où
lui ne peut aller, soufflant sur sa
voix dès qu’il s’agit d’elle.
Qui, sinon le poète, sinon Thierry Metz, poète, aurait pu donner à lire dans « la même geste » du poème, la catastrophe, son origine et son déploiement boulimique à en dévorer jusqu’à la moelle les mots de Dominique, à ne se développer que dans les cercles d’épaisseur qui enveloppent l’enfant devenu gros et muet plutôt que grand et être de parole à cause de l’absurdité d’un temps qui passe, ne passe pas, ne passe plus, n’est jamais passé, toujours revenu.
Dans son livre l’art, l’éclair de l’être, Henri Maldiney écrit : Le réel est ce qu’on n’attendait pas et qui, sitôt paru, est depuis toujours là.
Paul Celan dans une lettre à Hans Bender écrit :
Les poèmes sont aussi des cadeaux – des cadeaux pour ceux qui sont attentifs. Des cadeaux qui amènent avec eux le destin.
Ainsi le présent, cadeau du poème, contiendrait la totalité de l’histoire, il renoncerait au visible et à l’impermanence de l’instant au profit de l’invisible, du sous-jacent, du déroulement de la trajectoire. Il donnerait en entier ce qui ne se montre qu’au travers de bribes et de fragments. Ainsi il tiendrait. Il ferait le lien. Il lierait les deux bords.
Entre les bords, le vide, l’abîme. Entre les bords, le réel peut-être.
La première réponse à l’abîme est le vertige, le rythme est la seconde réponse à l’abîme écrit Henri Maldiney.
Le travail poétique fait apparaître par l’avènement du poème, l’événement même.
Un événement n’a ni modèle ni analogue : il déchire la trame de l’attente et des possibles (…) une œuvre n’est œuvre que si elle est un événement et non l’image (il n’y en a pas !) de l’événement nous dit Maldiney.
La mise en œuvre de l’œuvre, la mise en forme de la forme, voici le mouvement du poème et ce mouvement est un rythme et ce rythme de langue est rythme de vie. Il est respiration.
L’autre soir Mireille Irvoas me disait : l’invisible inspire, le visible expire. L’expiration est le souffle créateur, c’est pourquoi seuls les mortels créent. La création c’est l’incarnation.
L’écriture serait alors tout à la fois l’apparition du réel et les conditions de son apparition. Elle serait également le lieu – témoin maïeutique de la présence au monde de celui qui écrit, de celui qui se tient en face de quoi on ne sait pas. Pour essayer de tenir, de ne pas succomber au vertige, la langue tente d’articuler quelque sens, la langue tente de dire qu’il y a quelqu’un et qu’il est là.
Et Henri Maldiney :
Un rythme est inobjectivable, il ne peut qu’être vécu. Le rythme est l’articulation du souffle. Le rythme est à la fois la réalité du réel et l’abstraction constitutive de tout art.
Plus loin, je cite : Le réel est ce que je ne peux imaginer. Il est de soi sur-prenant, excédant toute prise, tout système de captage et de retenue. La sur-prise est co-originaire avec l’existence. « Il y a » dit « j’y suis ».
Dans l’avènement du poème, dans l’événement de son avènement, le poète invente tout à la fois le monde et sa présence au monde. Il n’est pourtant pas question d’imaginaire, encore moins d’imagination, mais d’originaire et de création.
Une « Montagne Sainte Victoire » de Cézanne ou les « kakis » de Mouch’I vous éveillent à un espace si réel qu’il vous arrache à l’irréalité des perceptions communes écrit de nouveau Maldiney.
Le poème comme toute œuvre d’art indique l’Ouvert là où, en dehors de l’œuvre, nous subissons la limite et la limitation de nos sensations.
Le poème a les yeux de l’autre côté.
Il a traversé le miroir. Oui. Non.
Il est le miroir. Il est la traversée. Il est le passage. Il est le lieu, l’instant et le souffle du passage.
Il ne reste rien. Et c’est le rien du poème ; la trace, l’empreinte du réel.
Si le poète est éreinté par le poème, c’est que le travail d’Orphée implique simultanément et la présence et l’absence. C’est parce qu’il lit à mesure ce qu’il écrit et qu’il est difficile, littéralement, d’en re-venir. C’est parce que le passage est étroit, que le temps du suspens entre-deux est fugace et fragile.
Le passage, est peut-être ce lieu - temps absent entre deux points dont l’un serait le point d’équilibre et l’autre, le point de déséquilibre. Entre les deux points, le point absent du réel. Le centre absent du poème.
Il faudrait pouvoir danser.
C’est peut-être de cette danse dont témoigne Jorg Much dans un article paru dans le journal de Frankfurt en 1956 :
En 1921, lorsque Paul Klee entra au Bauhaus, il s’installa dans un atelier voisin du mien. Un jour, j’entendis un bruit étrange, comme si quelqu’un frappait du pied en cadence.
Rencontrant Klee dans le corridor, je lui demandai s’il avait remarqué quelque chose.
- Ah ! vous avez entendu ! excusez-moi, me dit-il. Je peignais, je peignais, et tout d’un coup, ça a été plus fort que moi : je me suis mis à danser. Vous m’avez entendu. Je suis navré. Autrement je ne danse jamais.
Danse. Transe. Voyage dans un autre monde, dans un entre monde. Est-ce réminiscence ou est-ce prophétie, est-ce appel ou est-ce projet, est-ce jouissance de voir ou jouissance d’avoir vu, est-ce lire ou est-ce être lu ?
(…)
on voit c’est soudain la ligne une ligne
s’écarter d’elle-même et c’est impossible
fente palpébrale s’ouvrant à ses pieds
voit-on son propre œil s’écarter pour lire ?
car ça n’est pas voir et c’est à tâtons dans
des repliements et c’est paysage et funambuler
c’est lire oui non c’est être lu
(…)
Ainsi écrit Caroline Sagot Duvauroux dans le long poème d’Hourvari dans la lette.
C’est voir et ce n’est pas voir. Immédiatement surviennent à ma mémoire les grands yeux de pierre des statues de voyants et l’une des injonctions poétiques d’Arthur Rimbaud dans sa lettre du 13 mai 1871 à Georges Izambard :
Je veux être poète, et je travaille à me rendre Voyant : vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer.
Il ne suffit pas de posséder une boule de cristal pour pouvoir lire passé présent et avenir. Le cristal ne prend sa qualité de cristal, pierre de voyance que si celui qui le possède est en état de voyance. La poésie n’est poésie non par la forme extérieure qu’elle saurait donner à lire mais par la forme intérieure, mouvement poétique, qu’elle donne à Voir et qui ne surgit que parce que quelqu’un, le poète, a Vu.
Tertön, ce mot tibétain signifie : découvreur de trésor. Il s’agit d’initiés qui, par l’expérience que nous nommerons vision et qu’ils appellent transmission directe, reçoivent un savoir très ancien et oublié, qu’ils exhument de la nuit des temps et rendent vivants de nouveau à travers leur enseignement.
Le poète serait un Tertön de la langue qui écrirait avec et malgré la cécité des yeux ordinaires, avec et malgré l’ensevelissement, avec et malgré l’oubli, avec et malgré ce qu’il ne sait pas mais qu’il trouve. Un Tertön qui, par l’effacement du jour très humain, au profit d’une nuit d’humanité, éclairerait peu à peu quelques pans du réel, retenus dans les fausses clartés des mots qui luisent en surface.
Le poète dé-couvre.
Et il ne sait pas d’avance.
Avant la vision il n’y a pas de poème. Et la vision du poète ne surgit que dans l’écriture du poème. Elle ne préexiste pas. Elle existe dans et avec.
C’est pourquoi, pour ma part, et c’est, littéralement, un point de vue, une obligation de parti pris depuis que je fréquente les œuvres des poètes, la poésie qui ne tiendrait son nom qu’à une forme extérieure à elle-même ou qui ne viendrait que par un jeu de langue en place de jouissance, usurperait en quelque sorte et son nom et son lecteur.
Le poète, bien évidemment, pour sa trouvaille du poème, travaille la langue dans toutes les directions : il la déploie ou la défroisse, déplie, démultiplie, défriche, déchiffre à l’horizontal , à la verticale, à l’oblique, à la spirale, autrement et ailleurs très sûrement encore.
Il creuse, il pioche pourrait dire Jacques Dupin. Il fouille l’axe du paradigme et de son énigme comme celui du syntagme et de sa contamination, de ses ruptures, de ses sauts et de ses rappels.
C’est aussi dans les mots même que gît le cristal de roche.
Dans les mots et dans leurs écarts et proximités, et mouvements d’écrire et rythmes et autre chose encore perçu dans l’embrasure.
J’ai cru traverser vivant, les yeux ouverts, le nœud dont je naissais. Une souffrance morne et tolérable, un confort étouffant se trouvaient d’un coup abolis, et justifiés, par l’illumination fixe de quelques mots inespérément accordés.
écrit Jacques Dupin dans l’embrasure.
Aussi,
Extraire le corps
de sa gangue de terre
brûlée, de terre
écrite
Jacques Dupin, dans le corps clairvoyant
C’est un travail corps à corps avec la chair et les os des mots et le sang et le cœur battant de la langue, c’est un acte physique d’amour, parfois c’est l’orgasme et c’est l’objoie de Francis Ponge, parfois c’est le désastre et c’est l’encre irréparable dont parle Bernard Noël à propos de l’écriture de Jacques Dupin.
Dans l’orgasme comme dans le désastre, il est question de rencontre et de mystère.
Question de rencontre avec soi, c’est-à-dire de rencontre hors de soi, de rencontre avec le dehors qui est dedans. Je est un autre ne cesse de nous écrire Rimbaud.
Il est question du réel qui frapperait à la porte ou passerait par la fenêtre malgré la clôture des volets ou tancerait le désir de dire par le besoin de taire.
Le poème est un tissu troué. Un tissu de déchirures. écrit Dominique Fourcade.
Pas raccommoder, pas recoudre, trouer le trou, creuser le creux, écarter, fissurer, saigner, écorcher, pas polir l’apparence, pas lustrer, pas fignoler, arracher, chercher, trouver, perdre, jouir, mourir, recommencer, travailler – là.
Tout jadis.
Jamais rien d’autre.
D’essayer.
De rater.
N’importe.
Essayer encore.
Rater encore.
Rater mieux.
Ce texte-poème de Samuel Beckett dans Cap au Pire.
Quoi dire mieux de l’impossible toujours réitéré d’atteindre, d’attendre aussi bien. Mais, de cette attente infatigable quoique épuisée, faite défaite et refaite, armé d’une langue incorporée, à recracher, mêlée de parts obscures, armé d’une langue entachée de nuit, désarmé à jamais devant l’ampleur et la terreur parfois.
Ecrire comme résister. Entrer dans le maquis, faire tache dans le paysage cousu de fils blancs.
Le cristal de roche empêtré dans la glaise sémantique.
Le cristal de roche dissimulé dans la matière physique et sonore des mots, dans leurs constellations.
Le cristal de roche aussi dans le souffle et le geste, dans la lettre même.
Peu de temps avant sa mort en 1979 à la pension « Pluie de roses » où il vivait depuis dix ans entre solitude, cancer et logogrammes, Christian Dotremont confiait à son ami Pierre Alechinsky son désir de travailler « à la lettre ».
« A la lettre », lui qui, pour tracer ses logogrammes, ses poèmes d’encre à l’écriture cursive et peinte dans le même temps, avait, il n’y a aucun doute, une relation si intime et si profonde déjà et avec la lettre et avec le geste d’écriture et avec le souffle.
Aussi, dans l’absence d’encre et de papier, dans la neige et la glace de Laponie Finlandaise, la trace invisible quoique empreinte en nous de ses logoneiges et de ses logoglaces ; Christian Dotremont, le bras poursuivi par un bâton, écrit.
A propos des logogrammes, il écrira :
S’élancer de presque rien qu’un peu de terre ou de papier avec une forte vitesse brève, entreprendre de s’emporter, emporter tout.
Dans son atelier installé dans le grenier de « Pluie de roses », à son ami Karel Appel venu le visiter, après avoir écrit un logogramme, il dira :
C’est le seul manuscrit du texte. J’écris. Copier n’est pas écrire. Mais je ne regrette plus la manie progressive de notre écriture. J’avance puis je recule, je patine, je place les lettres où ça me chante. C’est de l’écriture que je charge d’écriture.
Dans un texte de 1968 où il présente son travail, Dotremont écrit encore :
je ne vous demande pas de savoir lire mes logogrammes, je vous suggère de voir dans leur écriture exagérément naturelle, excessivement libre, le dessin, le dessin non-naturaliste, certes, mais de toute façon matériel, de mon cri ou de mon chant ou des deux tout ensemble ; après quoi vous pouvez lire le texte toujours écrit en petites lettres lisibles, calligraphiques, au crayon, sous le logogramme.
(…) Je ne cherche pas la beauté, je la trouve parfois, et alors je l’accepte.
(…) Mon but n’est ni la beauté ni la laideur, mon but est l’unité d’inspiration verbale-graphique ; mon but est cette source.
Il conclura ce texte par :
Il m’arrive d’avoir le sentiment, quand je trace un logogramme, d’être un Lapon en traîneau rapide sur la page blanche, et de saluer la nature comme au passage, par la forme même de mon cri ou de mon chant ou des deux tout ensemble. En tout cas, si la Laponie n’existait pas, je ne ferais pas de logogrammes ; je ne ferais rien du tout.
Le but est la source, l’écriture se charge d’écriture, la nature entre dans le texte, l’inspiration et l’expiration sont contenues et délivrées d’un seul tenant, de même le texte et la forme, dans l’avènement du poème ; Christian Dotremont écrit en apnée ce qu’il a trouvé qu’il appelle cri, qu’il appelle chant, qu’il appelle cri et chant et que nous lisons poème.
Christian Dotremont écrit-peint ce qui lui vient de la nuit polaire qui est le jour aussi.
Un logogramme :
à la clé qui ouvre afin d’emplir, de serrer l’origine de la nouure,
d’allumer la nuit pour anuiter le jour, entre chienne – et – loup, entre
chien – et – louve,
Un autre maintenant vient m’aider à ne pas conclure, à ne pas savoir, car en fait je ne sais pas. ce n’est pas quelque chose que je sais, c’est quelque chose que j’essaye de dire.
Un autre qui écrivait en 1948 je suis trop exigeant pour vivre, un autre, Stanislas Rodanski qui, à sa demande fut placé dans une « maison de santé » à Lyon de 1954 à sa mort en juillet 1981, un autre qui écrivait peu de temps avant sa disparition :
Cependant le paysage a basculé : une fois encore je vais céder le pas à l’ordre du jour qui vient avec le beau cortège de ses apparences.
Un autre qui écrivait :
Le souffle qui traverse un poème, son envolée, c’est toujours le passage de ce grand aigle blessé dans l’œil augural des visionnaires.
Cet autre qui écrivait :
Cependant le poète est né de l’éclat d’un rayon brisé, d’un coup d’épée dans l’eau, du heurt d’une lance contre le miroir d’un bouclier.
Cependant le jour se lève. Naissance du poète, l’artiste parle d’or et fait le silence.
----